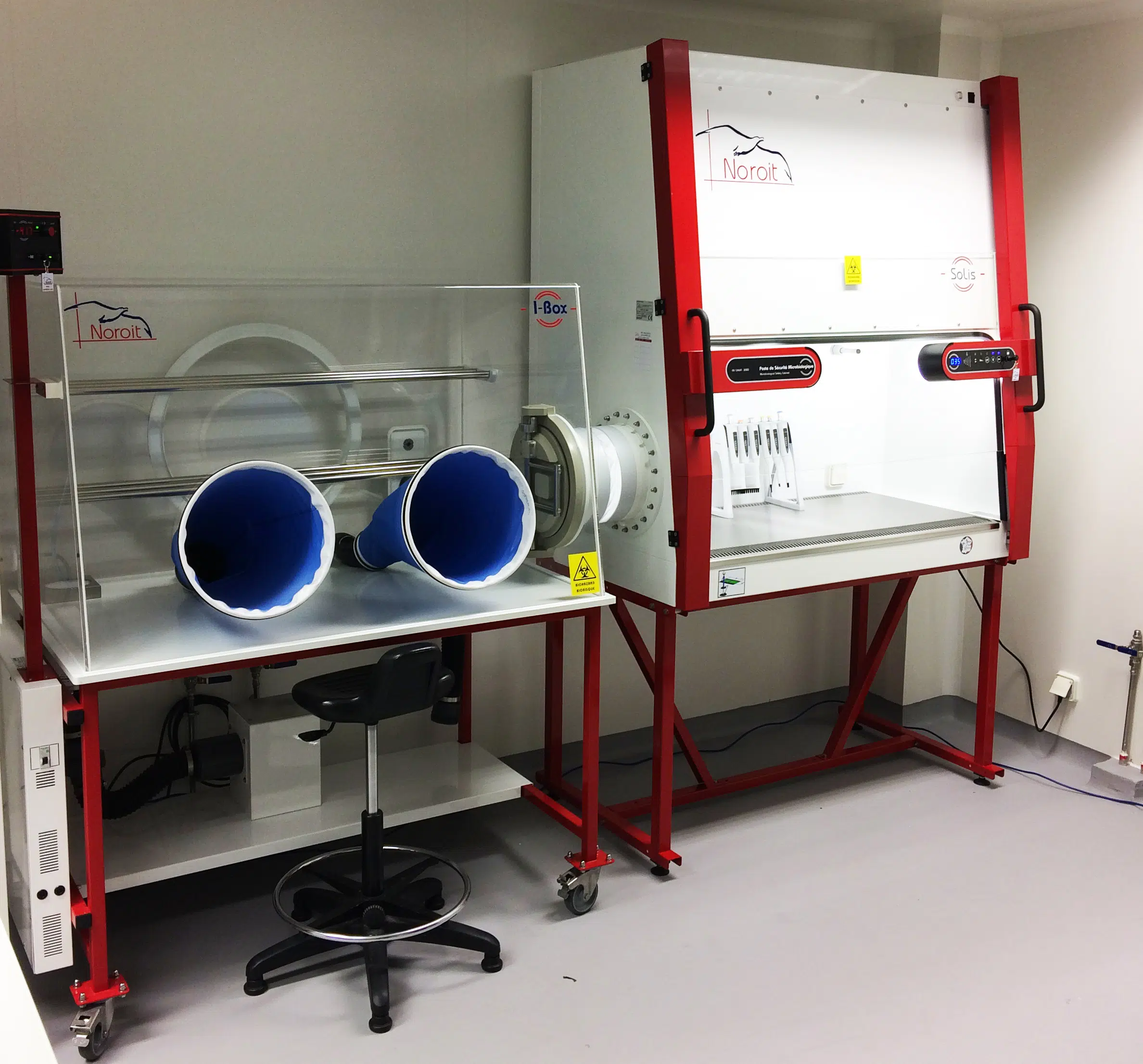Plus de la moitié de la superficie terrestre française est dédiée à l’agriculture, selon les données du ministère de l’Agriculture. En 2023, 53 % du territoire métropolitain était occupé par des terres cultivées, des prairies ou des pâturages. La France détient ainsi l’une des plus grandes surfaces agricoles d’Europe, loin devant l’Allemagne ou l’Italie. Cette emprise façonne la structure économique nationale et influe directement sur les politiques d’aménagement, de développement rural et de souveraineté alimentaire.
La France, un pays agricole : quelle place pour les terres cultivées ?
Le poids de l’agriculture façonne l’Hexagone, c’est une évidence. Sur près de 27,7 millions d’hectares recensés, la terre agricole trace le squelette du territoire. De la Beauce jusqu’à la Gascogne, du Berry au Languedoc, la France déroule une mosaïque ininterrompue de champs, de prairies et de cultures. Rien de spontané dans cette configuration : elle est le fruit de choix historiques, affinés génération après génération.
L’éventail des exploitations françaises défie les généralités. Si la surface moyenne tourne autour de 69 hectares, chaque région joue sa propre partition. Les grandes structures céréalières de Beauce tutoient les 200 hectares, tandis que la Bretagne ou le Massif central restent le royaume d’exploitations à taille humaine, où polyculture et élevage familial persistent malgré les bouleversements du secteur. Un territoire, oui, mais une multitude de réalités agricoles.
Pour dresser le panorama, quelques chiffres éclairent la situation :
- En 2022, la surface agricole utile représentait 27,7 millions d’hectares.
- 53 % du territoire métropolitain sont occupés par l’agriculture.
- La moyenne par exploitation atteint 69 hectares.
Ce socle foncier hisse la France parmi les plus grandes puissances agricoles du continent. Entre blé, maïs, colza, vigne et prairies, la diversité des productions illustre la capacité d’adaptation des producteurs et la générosité des sols. Mais cet équilibre se fragilise : l’urbanisation et l’artificialisation progressent, rendant la préservation des terres agricoles urgente, loin d’être réservée à une poignée de spécialistes. Ces terres nourrissent, au sens strict, le débat collectif sur l’alimentation et l’environnement.
Qui détient les plus grandes surfaces agricoles aujourd’hui ?
Pour démêler la question du foncier, il faut regarder de près la composition des propriétaires et exploitants. Les individus et familles pèsent encore, mais la tendance est à la montée en puissance des sociétés, sous la bannière de formes juridiques diverses. Résultat : une concentration accélérée des surfaces, majoritairement exploitées aujourd’hui par des structures collectives, mieux armées pour investir ou accéder au foncier.
La situation est sans appel : les fermes se font moins nombreuses, mais grossissent. En 2023, les 10 % d’exploitations les plus grandes concentrent à elles seules près de la moitié de la surface utile. Les fermes dépassant 100 hectares se multiplient, à mesure que les petites unités, souvent transmises de génération en génération, affrontent des défis de taille : pression sur le foncier, concurrence féroce, passage de témoin difficile.
Quelques tendances structurent ce marché du foncier :
- Le système du fermage l’emporte largement, donnant la priorité à la location pour accéder à la terre et organiser sa transmission.
- Les sociétés agricoles (GAEC, EARL, SCEA) avancent, que ce soit en gestion ou en propriété du foncier.
Ce basculement interroge bien au-delà des chiffres. Quid de la transmission, de l’entrée des jeunes sur le marché, de l’équilibre entre rendement et attachement local ? Des enjeux brûlants, qui montrent que l’accès à la terre n’est jamais anodin, mais concerne la destinée d’un modèle agricole tout entier.
Zoom sur la répartition des terres : chiffres clés et grandes tendances
Impossible de parler d’uniformité : la France agricole affiche une diversité saisissante dans la répartition de ses terres. Sur près de 27 millions d’hectares de surface utile, le puzzle varie d’un bout à l’autre du pays. Dans l’Ouest et le Bassin parisien, ce sont les grandes exploitations céréalières qui règnent, héritières d’un long processus de remembrement et d’innovation. Le Sud-Est, quant à lui, décline à l’infini de petites parcelles dédiées à la vigne, aux fruits ou aux cultures maraîchères, résultat de traditions familiales profondément enracinées.
Un chiffre évolue d’année en année : la taille moyenne des exploitations. 69 hectares en 2020, contre 55 vingt ans auparavant. Pourtant sous cette moyenne, se cachent de réelles inégalités. Les grands ensembles s’imposent dans les régions céréalières ou d’élevage intensif. À l’inverse, les très petites entités, notamment dans les zones de relief ou méditerranéennes, luttent contre la concentration du foncier et peinent à soutenir la concurrence.
Pour y voir plus clair, faisons le point sur les principaux contrastes :
- Ouest et Bassin parisien : terrain de jeu des exploitations céréalières imposantes, structurées pour la performance et la mécanisation.
- Massif central, Alpes, Pyrénées : prééminence des prairies et de l’élevage, avec des sociétés agricoles ajustées à la topographie et à la coopération locale.
- Méditerranée et Sud-Ouest : une palette de cultures spécialisées, morcellement des surfaces, poids des héritages familiaux.
Un autre phénomène fait grincer des dents : l’extension des friches agricoles dans plusieurs départements comme la Sarthe, la Mayenne ou la Vendée. Les terres laissées à l’abandon gagnent du terrain, symptomatiques du vieillissement de la population agricole et des obstacles pour les candidats à l’installation. Ici se joue silencieusement la géographie rurale de demain, et la bataille pour faciliter l’arrivée de nouveaux porteurs de projet.
l’agriculture, un pilier économique et territorial à préserver
Plus de 81 milliards d’euros de production : la performance de l’agriculture française rivalise avec les plus grands du continent. À la base de ce dynamisme, il y a la surface agricole utile, levier indispensable pour nourrir la population, soutenir le tissu rural, maintenir l’équilibre entre les territoires.
Mais le contexte évolue. Sous l’impulsion de la politique agricole commune, l’organisation des campagnes françaises a longtemps suivi des lignes directives claires. Désormais, la pression monte : entre développement urbain, zones commerciales et lotissements, plusieurs milliers d’hectares disparaissent chaque année. L’État vise la neutralité en artificialisation, afin de sauver les terres nourricières et garder vivante la biodiversité. Cette course contre l’érosion foncière donne le ton des discussions sur les paysages, les filières agricoles et l’autonomie alimentaire du pays.
Trois défis majeurs s’imposent aux acteurs du secteur :
- La perte de biodiversité, accentuée par la disparition des haies et des prairies pérennes.
- L’influence des émissions agricoles sur le climat, avec l’urgence de transformer les pratiques vers davantage d’écologie.
- La souveraineté alimentaire, étroitement liée à la maîtrise et à la durabilité du foncier agricole.
Face à tout cela, des lois comme celle d’orientation et d’avenir agricole ou la loi Sempastous visent à freiner la concentration des terres et à limiter les achats à grande échelle par certains groupes. ONG, syndicats, collectifs alertent : choisir de maintenir la vocation nourricière du foncier est un acte collectif. Qui prendra la relève ? La question plane au-dessus des sillons, nous reliant à l’avenir de nos campagnes et des territoires vivants qu’elles façonnent.